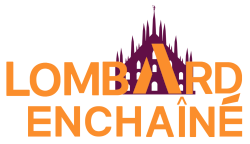Milan incarne à la fois le prestige du luxe et la frénésie de la fast fashion. Entre savoir-faire traditionnel et production de masse, la ville illustre les contradictions de l’industrie du textile. Mais face aux enjeux environnementaux, certains créateurs milanais défendent une mode plus responsable.

Milan, temple de la mode, brille par son célèbre Quadrilatero della Moda, où luxe et savoir-faire italien s’expriment à travers les maisons emblématiques comme Prada, Gucci ou Armani. Ce quartier raffiné, aux façades élégantes et vitrines somptueuses, symbolise l’excellence du « made in Italy ».
Située à l’angle de la Via della Spiga et du Corso Venezia, la responsable de la boutique Dolce & Gabbana botte en touche timidement quand on lui demande si des efforts sont faits vers une mode plus vertueuse : « Nous avons certaines collections qui se veulent éco-responsables, vous retrouverez tout ça sur notre site. » En cherchant bien, au milieu des différents articles aux prix exorbitants, se cache un petit onglet « Durabilité » où la marque présente son engagement envers des pratiques durables. Dolce & Gabbana promeut sans entrer dans les détails une approche « zéro déchet » et mise sur des matériaux plus durables. Sur son site, elle prétend réduire son empreinte carbone.
Un peu plus loin, dans le magasin Prada, le discours est aussi hésitant. Le manager élude : « Nous sommes dans un magasin avec beaucoup de passage, nous n’allons pas pouvoir répondre à vos questions. Envoyez-nous un mail. » Le magasin est pourtant vide, six vendeurs se tenant bien droit prêts à accueillir les clients. Pas plus de réponse donc, nous avons continué notre chemin.
Difficile de se mettre au vert dans le luxe
Direction la Via Monte Napoleone, entre les horlogeries et les bijouteries, on retrouve cet autre incontournable du luxe : Gucci. Une vendeuse, élégamment vêtue d’un blazer bleu marine aux boutons dorés, d’une chemise blanche et d’un pantalon de tailleur, nous propose une visite. Elle s’empresse de nous montrer cette toute nouvelle paire de basket : Cub3d. Son prix : 1 100 euros. Ce produit est composé de Demetra : « C’est un composant développé par Gucci, il est constitué à 70% de matières premières végétales. »
Cette matière est fabriquée à partir de viscose biosourcée, issue de sources végétales renouvelables comme la pâte de bois, de biopolymères dérivés du maïs, et de polyuréthane, une alternative synthétique d’origine végétale. La doublure se compose de 88% de polyester recyclé et ce cuir est tanné sans métal ni chrome. La marque a également supprimé l’utilisation de la fourrure à partir des collections de l’année 2018. Gucci a été rejointe par d’autres marques telles que Bottega Veneta ou encore Balenciaga, en 2021.
Bien que ces grandes maisons essaient d’afficher une démarche éco responsable, le luxe a visiblement du mal à se mettre au vert.
Du greenwashing ?
« Les grandes maisons de luxe ne ralentissent pas leur production, alors que c’est essentiel. En regardant les étiquettes en magasin, on voit encore beaucoup de polyester et de tissus nocifs, fabriqués dans des conditions déplorables. » C’est ce que constate Marina Savarese, l’une des fondatrices du Movimento Moda Responsabile (MMR), qui qualifie les discours sur l’éco-responsabilité de ces marques de « greenwashing ». À travers cette technique de communication, ces grandes marques tentent de se donner une image écologique.

Fondé en avril 2023, le Movimento Moda Responsabile réunit des marques, des entreprises et des associations du secteur de la mode. « On s’est dit qu’on devait faire quelque chose pour faire entendre notre voix. L’un de nos objectifs était d’évoquer les sujets liés à la mode durable au public d’une manière plus compréhensible », raconte Marina Savarese. Le mouvement souhaite promouvoir une mode durable et éthique au plus grand nombre.
Le MMR organise divers événements : ateliers, conférences et actions de sensibilisation. Ces initiatives se concentrent sur l’impact environnemental, la gestion des ressources, la réduction des déchets et les conditions de travail dans l’industrie textile. Le mouvement sensibilise également les consommateurs à travers différentes campagnes de communication sur les réseaux sociaux.
« On mélange le cachemire à des épices »
Mais, si les grandes maisons qui ont des moyens ne s’engagent pas, d’autres acteurs sont-ils plus actifs pour engager la mue écologique de la mode ? C’est tout près de la périphérie Milanaise, dans une zone industrielle et commerciale que nous avons découvert le showroom d’As Sustainable As Possible (ASAP). Cette marque fondée en 2007 par Carla Lasorte et son mari Alberto Zanone propose une collection, qu’ils vendent comme 100% « made in Italy ». Loin des beaux quartiers du centre de Milan, dans le nord-ouest de la ville, au cœur du quartier Certosa, on pigmente ici le cachemire grâce à des épices.
Manuel Berera, responsable du showroom, nous présente les différentes étapes de pigmentation du cachemire : « On mélange le cachemire à des épices comme le curcuma, la grenade ou la myrtille. » Pas besoin de produit chimique, au toucher le curcuma laisse des tâches jaunes sur nos doigts. « La teinture végétale coûte cinq fois plus cher qu’une teinture normale car c’est beaucoup plus long. Elle s’effectue dans le Piémont », précise Carla Lasorte. Certains modèles d’ASAP sont fabriqués à partir de fibres naturelles non teintées. La marque propose également une ligne de vêtements réversibles, conçus dans une démarche durable.
« Je ne dis pas que je ne pollue pas, ça serait un mensonge. »
Carla Lasorte, fondatrice de la marque ASAP
Le couple travaille avec de petites usines spécialisées : les accessoires sont produits en Toscane et les pulls à Biella, dans le Piémont pour la laine. « On s’intéresse à la qualité et au respect du produit », souligne Manuel Berera. Mais cela a un coût. 150 euros le pull 100% cachemire, par exemple. « Les prix peuvent paraître élevés mais le produit tient 20 à 30 ans et nous payons le cachemire assez cher au kilo », défend Manuel. Un tarif qui peut atteindre 200 euros le kilo. Le marché fluctue également en fonction du rendement des élevages de chèvres. Le cachemire vient de la région Mongolie-Intérieure, la meilleure en la matière. Bien que la marque fasse au mieux pour limiter son impact, cela a des limites. Cette matière est principalement importée d’Asie.
« Il faut un climat très froid pour pouvoir produire une meilleure fibre d’où cette région en Mongolie, plus la fibre est longue, mieux c’est pour que le produit dure », détaille Carla Lasorte, avant d’ajouter : « Je ne dis pas que je ne pollue pas, ça serait un mensonge, mais on travaille vraiment sur une pollution moindre. »
« En tant que créateur indépendant, on survit »
Irène Benatti a elle aussi lancé son atelier de création en 2016, dans le quartier Giambellino-Lorenteggio, situé au sud-ouest de Milan. « Je ne travaille pas en collection, je privilégie la qualité à la quantité », assure Irène Benatti. La créatrice produit trois ou quatre tailles à l’unité, mais pas plus. Puis selon la demande, elle assure la production.
Ses matières sont issues de la récupération textile, de restes d’entrepôts et de fermetures d’entreprises. « En tant que créateur indépendant, on survit. Même si j’ai une clientèle fidèle, j’hésite à augmenter mes prix. Il y a beaucoup de travail et de charges : le loyer de l’atelier, l’électricité, les taxes », déplore-t-elle. 34 à 55 euros le pull, 130 euros une veste et 100 euros le pantalon, la créatrice propose des prix « moyens ».
« En Italie, le problème du pouvoir d’achat n’aide pas mais les clients reviennent quand même », sourit Irène. C’est grâce au bouche-à-oreille que la créatrice a pu fidéliser sa clientèle. Elle reste tout de même positive pour la suite : « Cela ira mieux d’année en année, les gens commencent à comprendre la différence entre la fast fashion et le travail des créateurs. »
« Je ne sais pas si la société est prête à changer »
Qu’en pense la nouvelle génération de créateurs ? À l’institut de mode Marangoni, Lou Suchel, étudiante en troisième année, raconte : « Produire de manière responsable c’était un peu ma manière d’apporter ma pierre à l’édifice dans cette industrie, mais je perds un peu espoir. » Tout en préparant ses patrons, elle ajoute : « Je ne sais pas si la société est prête à changer, les créateurs sont nombreux à se soucier de ces enjeux mais si les clients ne sont pas là, on ne pourra rien faire. »