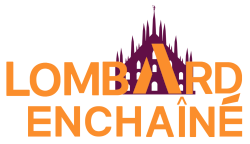Dans le quartier populaire de San Siro, au nord-ouest de Milan, des associations viennent en aide aux personnes immigrées. Des femmes, majoritairement égyptiennes, suivent chaque semaine des cours de langue italienne pour favoriser leur insertion sociale. Cette communauté est la plus importante de la capitale lombarde. Un premier pas vers l’insertion sociale.

Face à l’arrêt du tramway, les murs d’un bâtiment dénotent dans ce quartier populaire de San Siro. Le feuillage des arbres dissimule à peine ses grandes bandes colorées. Devant la porte d’entrée, un groupe de femmes de différentes nationalités discute. « Allez, c’est parti ! », lance une encadrante de l’association Itama, ce vendredi 28 mars, depuis le perron.
Dans le couloir, les femmes, pour la plupart égyptiennes, saluent les bénévoles avant de rejoindre la classe d’italien. Comme tous les mercredis et vendredis matin, un premier groupe de niveau élémentaire ouvre le cours, suivi d’un autre, plus en difficulté. À San Siro, au nord-ouest de Milan, un mur invisible scinde le quartier en deux parties : au sud, le secteur populaire fait de logements sociaux ; au nord, des résidences cossues réservées aux plus aisés.
« Il y a une ghettoïsation du quartier. Les Italiens du nord ne viennent pas dans le secteur sud, et inversement. »
Stella Bonnicacci, présidente d’Itama
Dans le premier, une majorité d’Égyptiens et d’Égyptiennes vit dans ces appartements, souvent insalubres et délaissés par les bailleurs sociaux. « Il y a une ghettoïsation du quartier. Les Italiens du nord ne viennent pas dans le secteur sud, et inversement. Cette sectorisation rend d’autant plus difficile l’intégration sociale de ces immigrés dans la société italienne », raconte la présidente de l’association Itama, Stella Bonnicacci, qui vit dans le secteur sud-ouest, celui « des classes moyennes ».
Les actions de la municipalité en faveur des étrangers « sont loin d’être suffisantes »
Cette communauté immigrée est la plus importante à Milan si l’on exclut les ressortissants de l’Union européenne. En 2023, elle représentait 16,2 % de l’ensemble des immigrés selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement. Depuis l’unification de l’Italie, en 1861, d’étroites relations lient les deux pays. « Leur proximité géographique et la forte implantation des Italiens au Caire et à Alexandrie ont influé, dans les années 1970, sur l’émigration économique des Égyptiens vers ce pays d’Europe du sud », détaille l’anthropologue Paola Schellenbaum, auteure d’une thèse sur les familles transnationales Égyptiennes de l’Italie. Vingt ans plus tard, « de nombreuses femmes ont rejoint leurs maris grâce à l’autorisation du regroupement familial », poursuit-elle.
Mais depuis 2022, et l’élection de Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia, un parti d’extrême droite), les étrangers subissent sa politique anti-immigration. Si la municipalité milanaise, de gauche, tente de répondre aux besoins des habitants, « ses actions sont loin d’être suffisantes », constate Stella Boccaccini. Alors, sur le terrain, les associations prennent le relais. Avec, parfois, quelques difficultés de communication entre bénéficiaires et bénévoles.

Une contrainte avec laquelle l’équipe du camion mobile d’urgence de Milan compose régulièrement. Chaque jeudi, le fourgon rouge de l’association Casa emergency s’installe sur la place Silunte. Les soignants proposent un accompagnement médical ouvert à tous et gratuit. À l’intérieur, tous s’activent pour prendre en charge un public généralement « précaire et démuni ». À Milan, l’association intervient « dans des zones où sont présentes différentes formes de précarité urbaine et d’exclusion sociale ». Pour échanger, professionnels et patients sont parfois contraints « d’utiliser un traducteur écrit voire oral », ce qui « complique la compréhension globale du problème et des solutions proposées » glisse une infirmière, en sortant du barnum à la toile cirée blanche.
L’accès à un titre de séjour conditionné à la maîtrise de la langue
Cette barrière de la langue, ce sont les mères au foyer qui en souffrent le plus. Car si leurs maris sont contraints d’apprendre très vite l’italien ou l’anglais pour trouver du travail ; elles, ne baignent pas dans un milieu italophone. De ce constat, est née l’association Itama en 2010. L’objectif ? Aider les femmes immigrées à s’insérer socialement grâce à l’apprentissage de la langue italienne dans le quartier populaire de San Siro.
Ce vendredi matin, Donatella, ancienne professeure de 58 ans, donne les instructions. « Ouvrez la page 156, on va corriger les exercices », indique-t-elle, dans son pull orange cintré, à côté de deux autres encadrantes également retraitées. Tour à tour, les femmes prennent la parole en italien avec enthousiasme et courage.
À l’image du quartier, « on accueille une majorité d’Égyptiennes. Mais il y a aussi des Marocaines et des Sud-Américaines », décrit Stella Boccaccini, qui fait vivre le lieu mis à disposition par la mairie avec près de 30 bénévoles. « Elles suivent ces cours jusqu’à l’obtention du niveau élémentaire (A2), le seuil requis pour obtenir le permis de séjour temporaire en Italie », poursuit-elle. Chaque année, grâce « aux donations » qui financent notamment l’achat des livres, sept femmes en moyenne obtiennent cette certification délivrée par l’Université de Milan.
Apprendre l’italien pour « échanger avec le professeur de ma fille »
Cette raison, celle de l’obtention d’un titre de séjour, n’est pourtant pas la première avancée par les Égyptiennes, qui aspirent avant tout à se réaliser en tant que mères dans ce pays qui leur est étranger. Arrivée il y a un an en Italie, Majda a rejoint l’association pour « pouvoir échanger avec le professeur de sa fille », scolarisée à l’école primaire. Pour d’autres, il s’agit d’assurer la communication avec leurs enfants nés en Italie. C’est le cas de Naglaa, 41 ans. Cette mère originaire du Caire a franchi le pas de la porte de la maison colorée il y a quatre ans. « Ma fille s’exprimait bien mieux en italien qu’en arabe. Je ne la comprenais pas, décrit-elle. C’était devenu trop difficile. »

Mais pour apprendre de manière sereine, il faut parvenir à se ménager un temps rien qu’à soi… sans enfants. Itama a donc mis sur pied une pouponnière, gérée par des bénévoles qui se proposent de garder leurs progénitures le temps de la leçon d’italien. « Car en Italie, les crèches sont onéreuses », appuie Stella Boccaccini. Mais toutes n’ont pas la chance d’accéder à cette aide : seules 65 inscriptions ont été retenues sur les 100 formulées l’année dernière. « On fait le travail de l’État, mais avec nos capacités… » souffle la présidente.
Les liens créés lors des cours perdurent en dehors de l’école. « Des groupes de solidarité informels se forment », remarque Donatella, qui habite dans le secteur ouest de San Siro. En fin de matinée, Randa, tunique violette aux fleurs brodées dorées, se rend chez son ami égyptien qui tient une pâtisserie à quelques pas d’Itama, Via Mariotto Albertinelli. Avec elle, deux amies du cours d’italien. Assises à une table, « on discute de tout et de rien, on échange parfois des astuces », énonce-t-elle. Ce dimanche, Randa, Wafaa et Dina se retrouvent pour célébrer l’Aïd. À Milan, les centres sociaux se substituent aux mosquées. C’est d’ailleurs dans celui de San Siro que les trois trentenaires fêteront la fin du Ramadan.